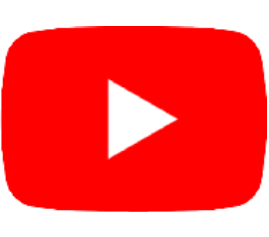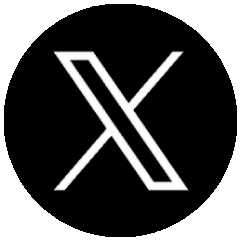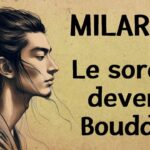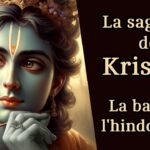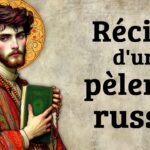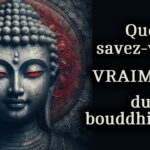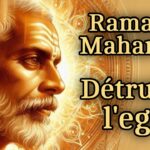Nous lirons aujourd’hui une histoire tiré de l’ouvrage Mystiques et magiciens du Tibet, écrit en 1929 par Alexandra David-Néel. Cette dernière, grande exploratrice et spécialiste du Tibet, fut parmi les premiers à rapporter en Occident les enseignements des doctrines orientales (en l’occurrence, ceux du bouddhisme tibétain).
Elle raconte ici l’histoire de Karma Dordji, un homme qu’elle a rencontré durant l’un de ses voyages, et qui a vécu lui-même, dans sa jeunesse, une initiation spirituelle des plus atypiques. Découvrons le récit qu’Alexandra David Néel en fait.
L’histoire de Karma Dordji
Karma Dordji était issu d’une famille pauvre et de basse condition. Tout enfant, dans le monastère où ses parents l’avaient placé, il s’était vu en butte aux moqueries et au mépris des autres moinillons appartenant à une classe sociale supérieure à la sienne. Ces vexations avaient changé de caractère lorsqu’il était devenu plus âgé, mais nombre de ses collègues lui faisaient toujours sentir, même par leur silence, l’infériorité de son origine. Karma Dordji était fier et doué d’une rare force de volonté. Il me raconta qu’il n’était encore qu’un garçonnet quand il avait juré qu’il s’élèverait au-dessus de ceux qui l’humiliaient.
Sa naissance et sa condition de moine ne lui laissaient qu’un moyen de parvenir à son but. Il lui fallait devenir un grand ascète, un magicien, un de ceux qui subjuguent les démons et s’en font un cortège de serviteurs. Ainsi pourrait-il voir, tremblant devant son pouvoir, ceux dont il souhaitait se venger.
Dans ces dispositions rien moins que pieuses, il alla trouver le supérieur du monastère et le pria de lui accorder un congé de deux années, parce qu’il désirait se retirer dans la forêt pour méditer. Une permission de ce genre n’est jamais refusée. Dordji grimpa haut sur la montagne, trouva un endroit convenable près d’une source et s’y construisit une hutte. Tout de suite, pour mieux imiter les ascètes versés dans l’art de développer la chaleur interne, il rejeta tous vêtements et laissa pousser sa chevelure. Les rares personnes qui, à longs intervalles, vinrent lui apporter des vivres, le trouvèrent assis, immobile, nu, même en plein hiver, paraissant abîmé dans la contemplation.
On commençait à parler de lui, mais il était encore bien loin de la célébrité qu’il souhaitait. Il comprit que son ermitage et sa nudité ne suffiraient pas à la lui procurer. Il redescendit donc vers son monastère et, cette fois, sollicita la permission de quitter le pays pour chercher un gourou dans une autre région. On ne fît rien pour le retenir.
Ses pérégrinations furent beaucoup plus extraordinaires que celles d’Yéchés Gyatzo (NDLR : un autre yogi cité plus tôt dans le livre), car ce dernier savait du moins où il allait, tandis que Karma Dordji l’ignorait.
N’arrivant pas à découvrir un magicien qui lui parût mériter sa pleine confiance, il résolut d’y parvenir par des moyens occultes. Karma Dordji croyait fermement aux déités et aux démons, il savait par cœur l’histoire de Milarespa qui fit écrouler une maison sur ses ennemis et s’en rappelait beaucoup d’autres analogues où les « Grands terribles » apportent, au milieu du kyilkhor (=mandala sacré) formé par le magicien, les têtes sanglantes qu’il a réclamées.
Dordji connaissait quelque peu l’art des kyilkhors. Il en construisit un avec des pierres, au fond d’une gorge étroite, et commença ses conjurations à l’effet d’être dirigé, par les déités redoutables, vers l’un des maîtres qu’elles servent. Dans le cours de la septième nuit, un grondement formidable se fit entendre. Le torrent qui coulait dans la gorge s’enfla soudainement. Une trombe d’eau, due peut-être à la rupture d’une poche d’eau ou à une pluie diluvienne survenue plus haut sur les montagnes, balaya le goulet où se trouvait le jeune moine et il fut emporté avec son kyilkhor et son menu bagage. Roulé parmi les rochers, il eut la chance extraordinaire de ne pas se noyer et échoua, au sortir du défilé, dans une immense vallée. Quand le jour vint, il aperçut devant lui un riteu (=ermitage) blottit à l’abri d’une muraille rocheuse, sur un éperon de montagne.
La maisonnette, badigeonnée à la chaux, apparaissait blanche rosée et toute lumineuse sous les rayons du soleil levant. Le rescapé crut voir s’en échapper des jets de lumière qui venaient se poser sur son front. Là, certainement, vivait le maître qu’il avait tant cherché. L’intervention des déités répondant à ses invocations ne faisait pas de doute. Alors que son intention était de remonter la gorge pour traverser la chaîne de montagnes, elles l’avaient – de façon un peu rude, il est vrai – dirigé en bas, vers la vallée, en vue de ce riteu.
Agréablement flatté par cette conviction, Karma Dordji ne donna même pas une pensée à la perte de ses vivres et de ses vêtements entraînés par le flot et, tout nu, ainsi qu’il s’était mis pour imiter Hérouka (un ascète nu du panthéon lamaiste), tandis qu’il officiait près de son kyilkhor, il marcha vers l’ermitage.
Comme il y arrivait, un disciple de l’anachorète en descendait pour puiser de l’eau. Il s’en fallut de peu qu’à la vue de l’étrange apparition qui surgissait devant lui, il ne laissât choir le récipient qu’il portait. Le climat du Tibet diffère grandement de celui de l’Inde et si, dans cette dernière contrée, les ascètes ou pseudo-ascètes, non vêtus, sont légion et n’étonnent personne, il n’en va pas de même au « Pays des Neiges ». Seuls, quelques rares naldjorpas (yogis/ermites de haut niveau) adoptent cette tenue et, vivant hors de tous chemins, dans les replis des hautes chaînes de montagne, ils sont rarement aperçus.
— Qui demeure dans ce riteu ? s’informa Karma Dordji.
— Mon maître, le lama Tobsgyais, répondit le moine.
L’aspirant magicien n’en demanda pas davantage. De quoi se serait-il informé ? Il savait tout d’avance ; les déités l’avaient dirigé vers le maître qu’il lui fallait.
— Va dire au lama que les Tcheu-Kyong (déités et démons) lui ont amené un disciple, prononça emphatiquement l’homme nu.
Tout ahuri, le jeune porteur d’eau alla avertir son maître et celui-ci commanda d’introduire le visiteur.
Après s’être prosterné avec dévotion, Karma Dordji recommença à s’annoncer comme disciple amené par les déités « aux pieds mêmes du maître ».
Le lama Tobsgyais était un lettré. Petit-fils d’un fonctionnaire chinois marié à une Tibétaine, il tenait sans doute de cet ancêtre une tendance à l’agnosticisme aimable. Probablement s’était-il retiré au désert plutôt par un goût aristocratique de la solitude et par désir de n’être pas dérangé dans ses études que pour tout autre motif. C’est, du moins, ainsi qu’il m’est apparu, d’après le portrait que m’en a tracé Karma Dordji. Lui-même avait été renseigné par les moines qui servaient le lama, car, comme on le verra, ses rapports avec ce dernier furent brefs.
L’ermitage de Kouchog Tobsgyais répondait, quant à sa situation, aux règles énoncées dans les anciennes Écritures bouddhiques : « Pas trop près du village, pas trop loin du village. » De ses fenêtres, l’anachorète voyait une vaste vallée déserte et, en franchissant la montagne contre laquelle s’appuyait sa demeure, l’on trouvait un village, sur le versant opposé, à moins d’une demi-journée de marche.
L’intérieur de l’ermitage était d’une simplicité ascétique mais comprenait une bibliothèque très bien fournie ; et quelques beaux thangkas (=tableaux) pendus aux murs indiquaient que l’ermite n’était ni pauvre, ni ignorant en fait d’art.
Karma Dordji, gaillard de haute stature, vêtu seulement de sa longue chevelure tressée en une natte qui, encore allongée par des crins de yak, lui battait les talons, devait étrangement contraster avec le lettré mince et raffiné qu’il m’a dépeint.
Ce dernier lui laissa raconter l’histoire du kyilkhor et de la crue « miraculeuse » du torrent et, comme Dordji répétait une fois de plus qu’il avait été amené à « ses pieds », il se borna à lui faire observer que l’endroit où les eaux l’avaient déposé se trouvait passablement éloigné de sa retraite. Puis il s’enquit de la raison pour laquelle l’apprenti sorcier voyageait déshabillé.
Quand Dordji, plein de lui-même, lui eut parlé d’Hérouka et des deux années qu’il avait passées sans vêtements dans la forêt, le lama le considéra un instant, puis, appelant un de ses serviteurs, il lui dit simplement :
— Conduisez ce pauvre homme à la cuisine, faites-le asseoir près du feu et qu’il boive du thé très chaud. Tâchez aussi de trouver une vieille robe en peau de mouton et donnez-la-lui. Il a eu froid pendant plusieurs années.
Et, sur ce, il le congédia.
Karma Dordji éprouva certainement du plaisir à endosser la houppelande de fourrure qu’on lui donna, toute loqueteuse qu’elle fût. Le grand feu et le thé généreusement beurré le réconfortèrent agréablement après son bain nocturne. Mais ce plaisir, tout physique, était gâté par la mortification de sa vanité. Le lama ne l’avait pas accueilli comme il aurait dû le faire pour un disciple qui lui arrivait « miraculeusement ». Cependant il comptait bien, après s’être restauré, faire comprendre à l’ermite qui il était et ce qu’il souhaitait. Mais Tobsgyais ne l’invita pas à reparaître devant lui et parut l’avoir complètement oublié. Sans doute avait-il donné des ordres à son égard, car on le nourrissait bien et sa place restait marquée auprès du feu.
Les jours passaient, Dordji devenait impatient ; la cuisine, toute confortable qu’elle fût, finit par lui paraître une prison. Il eût voulu au moins travailler, puiser de l’eau ou ramasser du combustible, mais les disciples du lama ne le lui permirent point. Le maître avait donné ordre qu’il se chauffât et qu’il mangeât, sans rien ajouter.
Karma Dordji devenait de plus en plus honteux d’être traité comme un chien ou un chat familier, que l’on soigne et dont on n’exige rien. Dans les premiers temps de son séjour, il avait plusieurs fois demandé à ses compagnons de le rappeler au souvenir de leur maître, mais ceux-ci s’étaient toujours excusés, répondant qu’ils ne pouvaient pas se le permettre et que si Rimpotché (=nom honorifique donné à un lama) désirait le voir il le ferait appeler. Il n’osa plus, ensuite, renouveler sa requête. Sa seule consolation fut de guetter l’apparition du lama qui s’asseyait, parfois, à un petit balcon devant sa chambre, ou bien de prêter l’oreille lorsque celui-ci, à de longs intervalles, expliquait un livre philosophique à ses disciples ou à quelque visiteur. À part ces rares lueurs dans son existence, les heures s’écoulaient, pour lui, lentes et vides, tandis qu’il revivait encore et encore, dans sa pensée, les diverses circonstances qui l’avaient conduit où il était.
Un peu plus d’une année se passa de la sorte. Dordji broyait du noir. Il eût supporté vaillamment les plus rudes épreuves que le lama eût pu lui imposer, mais cet oubli complet le confondait. Il en venait à imaginer que Kouchog Tobsgyais, par son pouvoir magique, avait deviné sa basse origine – bien qu’il se fût gardé de la lui avouer – et qu’il le méprisait, lui faisant, par pure pitié, l’aumône de son hospitalité. Cette idée, qui s’ancrait de plus en plus dans son esprit, le torturait.
Toujours convaincu qu’un miracle l’avait conduit près de ce lama et qu’il n’existait aucun autre maître, pour lui, au monde, il ne songeait point à recommencer ses recherches, mais la pensée du suicide traversait parfois son esprit.
Karma Dordji était près de sombrer dans le désespoir lorsque l’anachorète reçut la visite d’un de ses neveux. Ce dernier était un lama tulkou (=lama considéré comme la réincarnation d’un maître défunt), abbé d’un monastère, et voyageait avec une suite nombreuse. Rutilant en ses robes de brocart jaune, coiffé d’un scintillant chapeau de bois doré semblable au toit pointu d’une pagode, le lama, entouré de son cortège, s’arrêta dans la plaine, au pied de l’ermitage. De belles tentes furent dressées et, après s’être rafraîchi avec le thé que l’ermite lui envoya dans une énorme théière en argent, le tulkou monta à la maisonnette de son parent.
Pendant les jours qui suivirent, ayant remarqué l’étrange figure de Karma Dordji avec sa souquenille en peau de mouton et ses cheveux qui touchaient le sol, il l’interpella, lui demandant ce qu’il faisait toujours assis près du foyer. Dordji saisit cette occasion comme une nouvelle faveur des déités qui, enfin, tournaient de nouveau leurs regards vers lui et se présenta avec tous ses titres comprenant sa retraite dans la forêt, le kyilkhor dans la montagne, la crue du torrent, la découverte de l’ermitage, les rayons de lumière qui, partant de ce dernier, s’étaient posés sur sa tête, et termina par l’oubli dans lequel le lama le laissait, en priant le tulkou d’intercéder en sa faveur.
D’après ce qui ressortait du récit que j’ai entendu, le tulkou devait être d’une humeur à peu près semblable à celle de son oncle et peu enclin à dramatiser les choses. Il regarda avec étonnement l’herculéen Karma Dordji et lui demanda ce qu’il souhaitait que le lama lui enseignât.
Trouvant, enfin, quelqu’un qui s’intéressait à lui, l’aspirant sorcier reprit de l’assurance. Il voulait, répondit-il, acquérir des pouvoirs magiques, voler à travers les airs et faire trembler la terre ; mais il se garda soigneusement de mentionner la raison qui lui faisait désirer d’accomplir ces miracles.
Le tulkou s’amusait, sans doute, de plus en plus. Il promit néanmoins de parler à son oncle en faveur du quémandeur. Puis, pendant les deux semaines que se prolongea sa visite, il ne lui accorda plus un regard.
Le lama avait pris congé de son oncle et allait redescendre vers la plaine on sa suite l’attendait. Du seuil de l’ermitage, l’on voyait les domestiques tenant par la bride les beaux chevaux caparaçonnés de drap rouge et jaune, dont les selles et le harnachement orné d’argent poli luisaient sous le clair soleil matinal. Karma Dordji regardait machinalement le spectacle, songeant que celui qui devait intercéder pour lui ne lui avait transmis aucune réponse de l’ermite et, maintenant qu’il s’en allait, tout espoir l’abandonnait.
Il s’apprêtait à saluer le tulkou par les prosternations d’usage, lorsque celui-ci lui dit laconiquement :
— Suivez-moi.
Karma Dordji fut quelque peu étonné. On ne lui avait jamais demandé de rendre aucun service. Que pouvait vouloir le lama ? Les tentes et les bagages, empaquetés par les domestiques, étaient partis au lever du jour avec la caravane des bêtes de somme. Nul travail ne semblait à faire. Probablement, il s’agissait de porter à l’ermitage un objet que le lama avait oublié de remettre à son oncle.
Arrivé au pied de la montagne, le tulkou se tourna vers lui.
— J’ai, dit-il, fait part à Kouchog Rimpotché de votre désir d’acquérir les pouvoirs magiques que vous m’avez mentionnés. Il m’a répondu qu’il ne possédait pas, auprès de lui, la collection des ouvrages que vous devrez étudier à ce sujet. Celle-ci existe dans mon monastère et Rimpotché m’a commandé de vous emmener avec moi pour que vous puissiez commencer votre instruction. Il y a un cheval pour vous. Vous ferez route avec mes trapas (=moines serviteurs).
Sur ce, il lui tourna le dos et rejoignit le petit groupe des dignitaires de son monastère qui l’avaient accompagné dans son voyage.
Tous s’inclinèrent dans la direction de l’ermitage pour saluer respectueusement le lama Tobsgyais, puis sautèrent en selle et s’éloignèrent au grand trot.
Karma Dordji restait cloué sur place ; un domestique le poussa, lui mettant la bride d’un cheval entre les mains… Il se trouva sur le dos de la bête et trottant bon train avec les gens du lama, sans s’être rendu compte de ce qui lui arrivait.
Le voyage se passa sans incident. Le tulkou n’accordait aucune attention à Dordji qui partageait la tente et les repas de ses serviteurs cléricaux.
Le monastère du tulkou était loin d’être immense comme le sont certaines gompas (=monastère) du Tibet, mais tout petit qu’il fût son apparence était des plus confortables et la réalité ne démentait point l’apparence.
Le quatrième jour après son arrivée, un trapa vint avertir Karma Dordji que le tulkou avait fait porter dans un tshams-khang (=cabane/refuge de méditation) la collection des ouvrages que Kouchog Tobsgyais lui recommandait d’étudier soigneusement pour parvenir au but qu’il poursuivait. Il ajoutait que, durant sa réclusion, des vivres lui seraient régulièrement envoyés du monastère.
Dordji suivit son guide et se vit conduire à une petite distance de la gompa, dans une maisonnette agréablement située. Sa fenêtre commandait une jolie vue du monastère avec ses toits dorés et, au-delà, on apercevait une vallée encadrée par des pentes boisées. Posés sur des étagères, à côté d’un petit autel, se trouvaient une trentaine d’énormes volumes soigneusement enveloppés et serrés par des lanières entre des planchettes sculptées.
Le futur magicien se sentit rempli d’aise. Enfin, l’on commençait à le traiter avec quelque considération.
Avant de le laisser, le trapa lui dit encore que le tulkou ne lui prescrivait point un tshams (=rythme de vie religieux) rigoureux. Il demeurait libre de régler sa vie comme il l’entendait, d’aller puiser de l’eau au ruisseau voisin et de se promener si bon lui semblait. Ceci dit, il le quitta après lui avoir montré les provisions de bouche et de combustible déposées dans le tshams-khang.
Karma Dordji se plongea dans la lecture. Il apprit par cœur quantité de formules magiques et s’exerça à les répéter en attendant de pouvoir, à la fin de sa période d’étude, en demander l’intonation exacte à son gourou, le lama Tobsgyais, qu’il comptait bien revoir. Il bâtit quantité de kyilkhors d’après les instructions contenues dans les livres, usant plus de farine et de beurre à fabriquer des gâteaux rituels (tormas) de toutes les formes, qu’il n’en consommait pour sa nourriture. Il se livrait aussi à nombre de méditations indiquées dans ses livres.
Durant environ dix-huit mois, son ardeur ne se ralentit point. Il ne sortait que pour aller puiser de l’eau, n’adressait jamais la parole aux trapas qui venaient, deux fois par mois, renouveler ses provisions et ne s’approchait jamais de sa fenêtre pour jeter un regard au-dehors. Puis, peu à peu, des pensées qui ne lui étaient jamais venues auparavant, s’infiltrèrent dans ses méditations. Certaines phrases des livres, certains dessins des diagrammes lui parurent receler une nouvelle signification. Il s’arrêta devant sa fenêtre ouverte, regardant les allées et venues des moines. Enfin, il sortit, parcourut la montagne, considérant longuement les plantes, les cailloux, les nuages errant dans le ciel, l’eau toujours fuyante du ruisseau, le jeu de la lumière et des ombres. Durant de longues heures, il restait assis, les yeux fixés sur les villages dispersés dans la vallée, observant les travailleurs dans les champs, les animaux passant chargés sur les routes, et ceux qui vagabondaient à travers les pâturages.
Chaque soir, après avoir allumé la petite lampe de l’autel, il demeurait en méditation, mais il ne cherchait plus, maintenant, à suivre les pratiques énumérées dans les livres, à évoquer les déités sous leurs divers aspects. Tard dans la nuit et parfois jusqu’à l’aube, il demeurait immobile, mort à toutes sensations, à toutes pensées, se voyant comme au bord d’un rivage et regardant s’avancer la marée montante d’un impalpable océan de blancheur lumineuse, prêt à le submerger.
Des mois se passèrent encore, puis, un jour, une nuit, il ne pouvait dire quand, Karma Dordji sentit que son corps se soulevait au-dessus du coussin sur lequel il était assis. Sans changer sa posture de méditation, les jambes croisées, il franchit la porte et, flottant dans l’air, parcourut l’espace. Enfin, il arriva dans son pays, devant son monastère. C’était le matin, les trapas sortaient de l’assemblée. Il reconnut nombre d’entre eux : des dignitaires, des tulkous, d’anciens condisciples. Il leur trouvait la mine lasse, préoccupée et chagrine, et les examinait avec un intérêt curieux. Comme ils lui apparaissaient petits de la hauteur où il planait ! Comme ils allaient être étonnés, effrayés, lorsqu’il allait se montrer à eux ! Et comme tous se prosterneraient devant lui, le magicien qui avait conquis les pouvoirs supranormaux !
Et puis cette idée même le faisait sourire de pitié ; la fatigue lui venait à considérer ces pygmées, ils ne l’intéressaient plus. Il songeait à la béatitude qui accompagne la montée de l’étrange océan de calme lumière dont aucune vague ne ride la surface. Il ne se montrerait pas à eux. Que lui importaient leurs pensées et que lui importaient les siennes propres : leur mépris ancien et le plaisir de la revanche…
Il se mouvait de nouveau dans l’air pour quitter la place… Alors, soudain, les bâtiments du monastère tremblèrent, se disloquèrent. Les montagnes environnantes s’agitèrent confusément ; leurs cimes s’écroulèrent tandis que d’autres surgissaient. Le soleil traversa l’espace comme un bolide, semblant tomber du firmament. Un autre soleil apparut, trouant le ciel. Et le rythme de la fantasmagorie s’accélérant sans cesse, Dordji ne discerna plus qu’une sorte de torrent furieux dont les flots écumants étaient faits de tous les êtres et de toutes les choses du monde.
Ces visions ne sont pas rares chez les mystiques tibétains. Il ne faut point les confondre avec des rêves. Le sujet n’est point endormi et, souvent, malgré les pérégrinations qu’il accomplit, les sensations qu’il éprouve et les tableaux qu’il perçoit, il conserve la conscience assez nette de l’endroit où il est et de sa personnalité. Maintes fois, aussi, quand les visions se produisent, lorsque la personne, en état de transe, se trouve dans un lieu où elle est exposée à être dérangée, elle éprouve de la crainte à ce sujet et souhaite, très consciemment, que nul ne survienne, ne lui parle, ne l’appelle, ne frappe à sa porte, etc. Bien qu’elle soit, parfois, dans l’impossibilité de parler ou de se mouvoir, elle entend et se rend compte de ce qui se passe autour d’elle. Le bruit, les allées et venues des gens, lui causent des sensations pénibles, et s’ils la tirent de l’état psychique particulier dans lequel elle se trouve, ou si, pour une raison quelconque, elle doit s’en sortir elle-même en accomplissant un grand effort, l’ébranlement nerveux qui s’ensuit lui cause, généralement, d’abord un choc douloureux, puis un malaise qui persiste longtemps.
C’est pour éviter cette commotion et les effets fâcheux que sa répétition peut avoir sur la santé, que des règles ont été édictées concernant la façon de terminer une période de méditation, même ordinaire, si elle a été quelque peu prolongée. Il convient, par exemple, de tourner la tête lentement de droite à gauche, de se masser le front pendant un instant, de s’étirer les bras en joignant les mains derrière le dos et en rejetant le corps en arrière, etc. Chacun choisit l’exercice qui lui convient le mieux.
Chez les membres de la secte Zen, au Japon, où les religieux méditent ensemble dans une salle commune, un surveillant exercé à discerner les symptômes de la lassitude soulage ceux qui en souffrent et ranime leur énergie en leur assenant un fort coup de bâton sur une épaule. Tous ceux qui en ont fait l’expérience s’accordent à dire que la sensation éprouvée est une agréable détente des nerfs.
Karma Dordji, revenu de son singulier voyage, regarda autour de lui. Sa cellule, avec les livres rangés sur leurs rayons, l’autel et le foyer, était telle que la veille et telle qu’il l’avait toujours vue depuis près de trois années qu’il l’habitait. Il se leva et alla regarder par la fenêtre. Le monastère, la vallée et les bois couvrant les versants des montagnes, avaient leur aspect habituel. Rien n’avait changé et, pourtant, tout était différent. Très calme, Karma alluma du feu, puis, quand le bois flamba, il coupa, avec un couteau, sa longue chevelure de naldjorpa et la jeta dans les flammes. Il fit ensuite du thé, but et mangea, posément, rassembla quelques provisions, les chargea sur son dos et sortit, fermant soigneusement la porte du tshams-khang derrière lui.
Arrivé au monastère, il se rendit à la demeure du tulkou, et rencontrant un domestique dans la cour d’entrée, il le pria d’informer son maître de son départ et de le remercier, en son nom, de la bonté qu’il lui avait témoignée. Puis il s’éloigna.
Il avait déjà franchi une certaine distance lorsqu’il s’entendit appeler. Un des jeunes moines de famille noble, appartenant à la maison ecclésiastique du lama, courait derrière lui.
— Kouchog Rimpotché vous demande, lui dit-il.
Karma Dordji retourna sur ses pas.
— Vous nous quittez, lui demanda poliment le lama. Où allez-vous ?
— Remercier mon gourou, répondit Karma.
Le tulkou resta un instant silencieux, puis, d’une voix attristée :
— Mon oncle révéré est parti au-delà de la souffrance, il y a plus de six mois, dit-il.
Karma Dordji ne prononça pas une parole.
— Si vous désirez vous rendre à son riteu, je vous donnerai un cheval, continua le lama, ce sera mon cadeau d’adieu à l’hôte qui me quitte. Vous trouverez au riteu un disciple de Rimpotché qui y demeure maintenant.
Karma Dordji remercia et n’accepta rien. Quelques jours plus tard, il revit la maisonnette blanche d’où la lumière lui avait paru jaillir et se poser sur sa tête. Il pénétra dans la chambre ou il n’était entré qu’une seule fois, le jour de son arrivée, se prosterna longuement devant le siège où le lama s’asseyait et passa la nuit en méditation.
Le matin, il prit congé du nouvel ermite et celui-ci lui remit un zen ayant appartenu au défunt qui avait recommandé de le lui donner lorsqu’il sortirait de son tshams-khang.
Depuis ce temps, Karma Dordji mena une existence vagabonde, quelque peu pareille à celle du célèbre ascète Milarespa, qu’il admirait, du reste, et vénérait profondément. Lorsque je le rencontrai, il était déjà âgé, mais ne paraissait pas songer à choisir un endroit pour y fixer sa résidence.
Il s’en faut de beaucoup que les débuts de tous les anachorètes tibétains soient aussi singuliers que ceux de Karma Dordji. Les circonstances de son noviciat sont même très particulières et c’est pour cette raison que je les ai relatées aussi longuement. Néanmoins, l’entraînement spirituel de tous les disciples des gomtchéns comporte, presque toujours, des détails curieux. Maintes histoires m’ont été racontées à ce sujet et ma propre expérience, souvent pas mal rude, du rôle de disciple au « Pays des Neiges » me porte à croire qu’un bon nombre d’entre elles sont parfaitement véridiques.
Fin.
De basses motivations
Véridique ou pas, cette histoire a la mérite de reprendre de nombreux enseignements propres à l’élévation spirituelle bouddhiste, qu’elle retrace du début à la fin.
On remarquera premièrement que les motivations initiales de Karma Dordji n’ont rien de noble ni de spirituel. Il est en quête de pouvoirs surnaturels, qu’il ne veut utiliser que pour se venger de ses anciens camarades et les terroriser.
Cet intérêt, purement égotique, est l’antithèse d’une motivation véritablement spirituelle. C’est pourtant ainsi que commencent de nombreuses aventures initiatiques. On pourrait après tout considérer que toute personne cherchant l’éveil spirituel est, par définition, dans le désir (le désir d’éveil, l’attachement à l’éveil). Ce sentiment est néanmoins toujours amené à s’affiner au fil de la pratique spirituelle pour devenir un intérêt pur, sincère et toujours plus désintéressé. En fin de parcours, le détachement est total et rappelle celui préconisé par Maître Eckhart et l’école du karma-yoga.
Tester la foi du disciple
Arrivé chez le cultivé lama Tobsgyais, Karma Dordji raconte son parcours et son désir d’acquérir des pouvoirs surnaturels. Il est persuadé que le lama le prendra alors comme élève et lui enseignera tout son art spirituel. Mais il n’en est rien et Tobsgyais envoie Karma Dordji patienter auprès du feu pendant une année entière.
La lecture du livre d’Alexandra David-Néel permet de comprendre que cette attente est voulue par Tobsgyais, qui ne compte donner d’enseignements qu’à un disciple dont il aura éprouvé la motivation. Cela revient souvent dans le bouddhisme, et les maîtres se méfient des élèves peu sérieux, ceux qui se lancent dans la quête initiatique sur un coup de tête puis qui l’abandonnent aussi vite, ou bien perdent rapidement confiance en leur maître, faute de résultats rapides.
En laissant Karma Dordji patienter toute une année, sans bien sûr lui mentionner que cette attente durera un an ni si elle aboutira à quelque enseignement, Tobsgyais l’éprouve jusqu’à ses limites. Tobsgyais veut savoir si Karma Dordji est assez motivé et assez confiant pour rester malgré tout assis à la cheminée, et c’est le cas. Karma Dordji a tenu bon.
Cette notion de confiance (de foi, même) est très importante dans le bouddhisme comme dans l’hindouisme. Le maître est révéré comme une divinité par son élève, et cette adoration est bien utile pour persévérer, des années durant, dans une pratique spirituelle parfois difficile, parfois déroutante, et souvent les deux à la fois.
L’illustre Milarepa fut lui-même tourmenté par son Maître Marpa, bien plus sévèrement que Karma Dordji. Marpa imposait à Milarespa de lourdes épreuves physiques. Il lui faisait par exemple bâtir des habitations puis lui demandait ensuite de les démolir. Il lui faisait encore porter des charges imposantes qui le blessaient. En plus de vérifier la patience et la confiance du disciple, ces épreuves ont pour effet de ternir son ego, et donc de le rendre plus humble. C’est le cas de Karma Dordji, qui se présente plein de fierté à Tobsgyais et qui, un an plus tard, est plus bas que terre et se compare à un chien qu’on méprise.
La confiance récompensée
La fin de cette épreuve d’attente est marquée par l’arrivée du moine tulkou, neveu de Tobsgyais. Ce dernier, sur demande de son oncle, emmène Karma Dordji avec lui, vers son ermitage. Très certainement, Tobsgyais a informé le tulkou de la détermination dont Karma Dordji avait fait preuve et lui a donc demandé de le traiter en disciple de valeur.
En conséquence, le tulkou installe confortablement Karma Dordji dans une cabane d’ermite où il ne manquera ni de nourriture, ni de combustible pour se chauffer, ni surtout d’enseignements occultes qu’il lui offre au travers de nombreux et épais ouvrages. Le tulkou ne lui impose pas non plus de routine religieuse, estimant sans doute comme son oncle que Karma Dordji est suffisamment motivé à apprendre pour qu’il ne soit pas nécessaire de cadrer son noviciat.
Le détachement
Il est intéressant de voir que, malgré cette évolution certaine qu’a connu Karma Dordji durant cette longue attente auprès du feu, il n’est toujours motivé que par un intérêt égotique : celui de se venger de ses camarades.
Mais ainsi qu’il fallait s’y attendre, une transformation plus profonde arrive au cours des mois suivants.
D’abord, Karma Dordji qui jusque-là lisait les ouvrages magiques, en apprenait les formules et confectionnait des kyilkhors adopte une pratique plus introspective :
« il ne cherchait plus, maintenant, à suivre les pratiques énumérées dans les livres, à évoquer les déités sous leurs divers aspects. Tard dans la nuit et parfois jusqu’à l’aube, il demeurait immobile, mort à toutes sensations, à toutes pensées, se voyant comme au bord d’un rivage et regardant s’avancer la marée montante d’un impalpable océan de blancheur lumineuse, prêt à le submerger. »
L’arrêt des pensées, l’arrêt des sensations et le silence intérieur sont des notions centrales dans toutes les spiritualités dignes de ce nom. Dans le bouddhisme évidemment, mais aussi dans l’école du raja-yoga, dans celle de l’hésychasme ou encore du soufisme.
Cet état est celui du détachement ou de l’indifférence aux choses extérieures, toujours au profit d’une contemplation intérieure.
On y voit aussi l’enseignement de la parabole du radeau, un autre enseignement bouddhiste : les livres, les formules magiques, les kyilkhors, sont pour le novice Karma Dordji des béquilles mentales, du concret pour un esprit qui a encore besoin de concret. Mais une fois son esprit affiné et renforcé, Karma Dordji n’a plus besoin de ces béquilles. Pire encore, elles l’appesantissent et l’encombrent dans sa quête de vide et de silence.
Union mystique
En communion avec lui-même et parfaitement indifférent aux choses de l’ego, Karma Dordji se retrouve finalement dans la présence d’une chose supérieure, qu’il décrit comme « un impalpable océan de blancheur lumineuse, prêt à le submerger ».
Difficile de ne pas y voir la présence divine telle qu’évoquée dans l’hésychasme et le soufisme en pareilles circonstances méditatives, ou la révélation du Soi décrite dans l’hindouisme.
Une « chose » merveilleuse, blanche, lumineuse, encore que ces mots soient sûrement des euphémismes, prêt à le submerger. Cette submersion fait écho encore une fois aux courants que nous avons cités, avec cette idée que l’on s’unit à ce principe supérieur, ou que l’on se fond en lui, ce qui est la même chose.
Le piège des siddhis
Karma Dordji, à présent spirituellement très élevé, développe spontanément le pouvoir de voler. C’est là un des nombreux siddhis (pouvoirs spirituels) qu’obtiennent les yogis à force de pratique et dont ils doivent se méfier. En effet, les pouvoirs rendent orgueilleux et l’orgueil nous rabaisse, sur le plan spirituel. Les pouvoirs spirituels sont donc un piège à éviter et les maîtres recommandent à leurs élèves de ne pas les utiliser.
Karma Dordji, lui, n’a nul besoin de cet avertissement. Revenu auprès de ses anciens camarades, l’esprit de vengeance et d’orgueil n’est plus en lui. Ce n’est pas qu’il a pardonné ses anciens camarades, c’est plutôt qu’il n’éprouve plus rien pour eux, ni en mal, ni en bien. Il les regarde depuis le ciel comme on regarde des fourmis s’agiter.
L’aboutissement de la quête spirituelle
Karma Dordji voit enfin le monde se disloquer autour de lui, comme dans un immense tourbillon de matière. De par sa hauteur spirituelle, Karma Dordji transcende le monde matériel illusoire et voit « tous les êtres et toutes les choses du monde » à la fois.
Karma Dordji atteint en quelque sorte une dimension métaphysique, hors de l’espace et du temps, qui le rend supérieur au monde. Il cesse d’être un personnage du film pour en devenir un spectateur, à distance. Les intérêts et les attachements qu’il avait pour le monde sont entièrement rompus.
Cet état supérieur, comme celui décrit dans d’autres courants, est de courte durée. Le yogi revient vite à un état « normal », mais n’oublie pas pour autant ce qu’il a vu. Son détachement ne le quitte pas non plus car, ayant réalisé le caractère illusoire du monde, il n’est plus capable de s’en éprendre.
Alors Karma Dordji, comme les autres êtres réalisés, poursuit sa vie dans le monde, mais dans le pur détachement, celui qui protège des désirs, de la peur et donc des souffrances. Karma Dordji est dans la paix totale, inaltérable et, ayant atteint le but de la voie spirituelle, il n’a plus rien à accomplir. Son chemin est terminé.
Voilà l’histoire de Karma Dordji, dont on ne saura jamais si elle est authentique mais qui a le mérite de retracer sous tous ses aspects l’initiation d’un moine bouddhiste (ici tout de même plus aventureuse que la moyenne) et ses effets sur son esprit. Ce récit nous rappelle qu’au-delà de l’image paisiblement folklorique que nous en avons, la voie spirituelle bouddhiste est, comme les autres, une aventure pleine de tourments, de doutes et de souffrance, dont le calme et la sérénité ne sont que la conclusion.