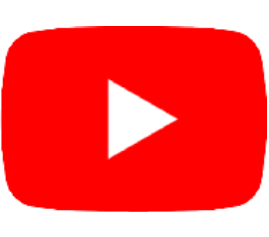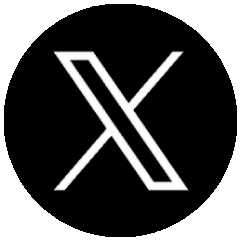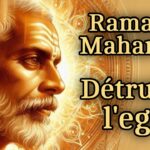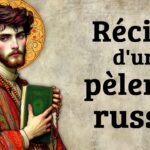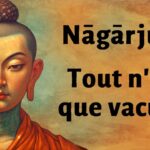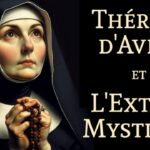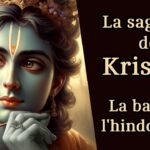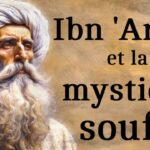Savez-vous qu’il existe un exercice commun aux différentes grandes spiritualités, considéré dans chacune d’elles comme une voie privilégiée pour atteindre Dieu ou le Soi ?
Cet exercice est dit de « répétition du nom » et porte différents noms d’une religion à l’autre. Il consiste, comme son nom l’indique, à répéter le nom de Dieu continuellement. Voyons cela plus en détail.
Dans l’hésychasme
On trouve premièrement cet exercice de répétition du nom dans le christianisme orthodoxe, et notamment dans l’hésychasme, où il est une pratique centrale. La répétition du nom est alors appelée « prière du cœur » (parfois « prière de Jésus »).
La prière du cœur consiste à répéter inlassablement une prière courte, généralement : « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. » On opte parfois pour une prière plus longue : « Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur » ou plus courte : « Seigneur, prends pitié. » Et cette prière doit donc être répétée sans cesse, tout au long de la journée, y compris durant les tâches de la vie quotidienne.
Instaurée et codifiée dès les premiers temps du christianisme, la prière du cœur est évoquée en détail dans les textes de la Philocalie, et de façon plus accessible dans l’ouvrage « Petite Philocalie de la prière du cœur ». Des grands noms du christianisme tels qu’Évagre le Pontique, Grégoire le Sinaïte, Saint-Jean Climaque, Grégoire Palamas et d’autres Pères du Désert y décrivent la prière du cœur, sa technique et ses effets. Ils témoignent également, de par leur importance dans la pensée chrétienne des premiers siècles, que la prière du cœur n’est pas un exercice marginal. Elle doit au contraire être vue comme le pilier central de l’hésychasme et même, sous son aspect contemplatif et méditatif, comme le cœur du cheminement monastique. Sa pratique est d’ailleurs conseillée aux chrétiens laïcs autant qu’aux moines.
La prière du cœur, finalement très simple puisqu’elle consiste à répéter cette courte phrase « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi », doit permettre selon ceux qui la décrivent de se concentrer sur Dieu, de le trouver en soi et même de se mêler à lui dans ce qui relève d’une union mystique ou de ce qu’Évagre le Pontique qualifiait de « contemplation première ». C’est là l’objectif suprême du moine hésychaste.
Dans le soufisme
Dans le soufisme, voie mystique de l’islam, il existe un équivalent de la prière du cœur que l’on nomme le « dhikr ». Il est très semblable à cette prière du cœur et en est d’ailleurs très certainement inspiré.
Dans le dhikr, il est aussi question de réciter inlassablement le nom de Dieu à la recherche d’une transe mystique ou d’une union intérieure avec le divin. Cette union est d’ailleurs mal perçue par les communautés musulmanes non soufies, qui y voient une association (le fait de mettre l’homme et Dieu sur le même plan), et donc un blasphème. Les autorités traditionnelles voient généralement d’un mauvais œil cette possibilité d’union divine, et l’opinion des traditionalistes sur la pensée soufie peut être comparée à celle de l’Église sur Maître Eckhart, côté chrétien. Il ne fait pas bon parler de déification de l’homme, ou de prétendre que l’homme peut, d’une certaine manière, participer à la nature divine. C’est en tout cas la pensée soufie.
Dans l’hindouisme
Dans l’hindouisme, la répétition du nom se retrouve sous le nom de « japa ». Il s’agit cette fois-ci encore de répéter sans cesse un nom divin.
Cet exercice fut vanté par Ramakrishna, Vivekananda, Swami Ramdas ou encore Ma Ananda Mayi, des grands noms de l’hindouisme contemporain. Tous font du japa une technique essentielle d’accès au Soi ou aux plus hautes sphères de la divinité.
Implicitement, le japa est même suggéré par la Bhagavad-Gita, un des textes les plus importants de l’hindouisme, ce qui en fait une technique de premier plan.
Dans le bouddhisme
C’est finalement dans le bouddhisme que la technique de répétition du nom est la plus discrète. On la nomme « nembutsu » en japonais et « nianfo » en chinois.
Il est dit que celui qui répète sans cesse le nom de Bouddha finit par atteindre l’éveil et échappe au samsara, le cycle des renaissances.
Peu importe le nom choisi
Vous aurez peut-être remarqué que si l’exercice de répétition du nom consiste à répéter le nom de Dieu, on répète pourtant dans le bouddhisme le nom de Bouddha, qui n’est pas censé être un dieu. Plus précisément, on répète le nom de Bouddha Amithaba, une figure divinisée de Bouddha, qui s’est répandue dans la croyance bouddhiste plusieurs siècles après sa mort.
Cela nous permet d’aborder un premier point : la répétition « du » nom de Dieu est en fait la répétition « d’un » nom de Dieu, ou encore du nom de l’une de ses incarnations, au gré des courants religieux. C’est la raison pour laquelle les hésychastes récitent le nom de Jésus, les bouddhistes celui de Bouddha, les soufis l’un des cent noms de Dieu, et que les hindous récitent tantôt Shiva, tantôt Vishnou, tantôt Krishna, tantôt Rama, etc.
Ces différences montrent que le principe divin se situe au-delà du nom que les hommes lui donnent. L’hindouisme insiste le premier sur le peu d’importance du nom choisi. La Bhagavad-Gita explique que le Dieu Suprême reçoit pour Lui-même les prières adressées avec foi à n’importe quelle divinité, comprenant qu’elles sont en réalité adressée à Lui seul. Ma Ananda Mayi, de son côté, répond à ceux qui lui demandent s’il faut prier Shiva ou Vishnou que cela n’a aucune importance, et que Dieu est à la fois l’un et l’autre. Elle-même, habituée à la récitation du nom de Shiva, se mit du jour au lendemain à réciter celui de Vishnou lorsqu’elle partit vivre chez la famille de son nouvel époux, vishnouite.
Le nom n’est qu’une étiquette
On retrouve ici une pensée évoquée par la parabole du radeau : celle que Dieu est sans forme, qu’il est indescriptible en tout point, et que le nom qu’on lui donne n’est finalement qu’une étiquette arbitraire qu’on lui accole, et le seul moyen de le définir sans en trahir l’essence.
En cela, le nom donné à Dieu est aussi interchangeable que celui de l’inconnu dans une équation. Cet inconnu est nommé x, mais on aurait tout aussi bien pu l’appeler y. Il est important de comprendre que ce nom « x » est ici le meilleur moyen de définir ce qui est indéfinissable, car toute tentative de deviner l’inconnu se solderait par des approximations et des erreurs. Ainsi, tant que la nature réelle de l’inconnu n’a pas été découverte, seul un nom arbitraire (et donc interchangeable) peut être utilisé pour le désigner. Changer ce nom du jour au lendemain ne modifie en rien la nature de ce qu’il désigne, pas plus que changer l’étiquette d’un pot de confiture n’en change le contenu.
Lorsqu’on répète un nom de Dieu, ce n’est pas ce nom que l’on prie mais bel et bien le principe suprême qui se cache derrière, et c’est ce dernier qui est contemplé. Le nom, lui, comme le radeau de notre parabole, n’est qu’un support auquel la pensée peut se raccrocher, tant qu’elle ignore la nature réelle de Dieu.
Se concentrer sur Dieu
C’est aussi parce que le nom donné à Dieu n’a pas de valeur intrinsèque que l’exercice de répétition du nom est en fait tantôt la répétition d’une prière (comme pour la prière du cœur), tantôt celle d’un mantra (comme dans l’hindouisme ou le bouddhisme) qui ne contient même pas forcément un nom divin.
Insistons : le nom donné à Dieu n’est pas une formule magique qui ouvre les portes de l’éveil à la manière d’un « Sésame, ouvre-toi ». C’est l’intention de la prière et la concentration sur Dieu qui importe.
Cette concentration est toutefois difficile, au moins dans les premiers temps de la répétition du nom. En effet, s’il est facile de répéter sans cesse, se focaliser sur ce que l’on répète l’est moins. En vérité, très vite au cours de l’exercice, la bouche se met à répéter de façon mécanique la prière ou le mantra, tandis que l’esprit vaque à d’autres pensées. La prière n’est alors qu’une activité mécanique que l’on fait sans s’en rendre compte. Selon certains, prier mécaniquement est mieux que rien, mais on considère généralement, dans tous les courants spirituels, qu’une telle prière est de peu de valeur.
Il faut alors apprendre la concentration, rejeter les distractions mentales, et l’on retombe donc sur un schéma commun à la majorité des voies spirituelles, celle comprenant d’une part une concentration sur un objet de méditation, et d’autre part une exclusion de toute autre pensée. En ce sens, l’exercice de répétition du nom n’est qu’une forme de méditation semblable à celle du raja-yoga ou comparable au détachement du karma-yoga.
Comment réciter le nom ?
Parmi les questions d’ordre technique, il y a celle de la récitation en elle-même : faut-il la faire à voix haute, à voix basse, ou même dans sa tête ?
Il n’y a aucune règle précise. La méthode change d’une religion à l’autre, mais aussi au sein des différentes écoles de ces religions, ou d’un enseignant spirituel à un autre. Il faut y comprendre que toutes ces récitations sont acceptables, encore que la répétition mentale (dans la tête) soit vraisemblablement la plus conseillée.
Saint-Païssios, moine hésychaste de premier plan, conseillait la prière mentale, ou bien une prière à voix basse, de sorte à ce qu’elle soit entendue par celui qui prie, mais pas par des personnes qui se trouvent dans la même pièce. D’autres préconisent la récitation à voix haute tant qu’on le peut, puis mentale lorsque la mâchoire ou la gorge devient douloureuse. Dans l’hindouisme, où le japa silencieux se mêle aux prières sonores du bhakti-yoga, cette considération semble sans grande importance.
Quelle position adopter lors de la répétition du nom ?
Faut-il réciter le nom de Dieu assis, couché ou debout ?
Si l’on recommande généralement des positions stables pour tout exercice de méditation, comme la position du lotus ou l’assise droite et parfaitement stable des moines zazen, il n’y a pas là non plus de règle officielle.
Cela est d’autant plus vrai que l’exercice de répétition du nom, ainsi que nous l’avons dit, est censé se pratiquer tout au long de la journée, y compris durant les heures de travail. Si donc il est préférable de rester assis, la prière debout ou en mouvement n’est pas une prière sans valeur. Elle peut en revanche être plus difficile à maintenir sans distraction.
On lit dans les récits des Pères du Désert que les premiers méditants hésychastes étaient souvent des ermites du désert égyptien. Ayant comme chacun besoin de manger pour vivre et d’argent pour manger, ils pratiquaient des activités manuelles telles que le tressage de panier. Cette activité manuelle mais peu intellectuelle leur permettait alors de maintenir leur concentration sur Dieu même durant leurs heures de travail.
Il serait cependant bien plus difficile de pratiquer la prière du cœur hésychaste tout en exerçant un métier intellectuel. L’objectif est de rendre le travail mécanique pour garder son esprit sur la prière. Mais lorsque le travail est prenant, c’est sur lui que l’intelligence se porte et c’est la prière qui devient mécanique.
En somme, peu importe donc la position de celui qui répète le nom de Dieu, pourvu qu’il maintienne sa concentration dans cet exercice.
Quel rythme de respiration ?
À nouveau, aucune instruction claire, et probablement pas de précaution particulière à prendre. Saint-Païssios dit que 100 prières du cœur ne doivent pas prendre moins d’une minute et trente seconde. C’est déjà un rythme de récitation très rapide. Une rythme de parole normal semble donc tout à fait convenable.
L’idée, ici, est d’éviter une récitation-express, qui permettrait de se débarrasser au plus vite des 100, 1000 ou 10 000 récitations demandées par l’enseignant spirituel. La prière récitée trop vite, toujours selon Saint-Païssios, est une prière expédiée, insincère et qui, très certainement, ne portera aucun fruit.
On propose souvent, dans l’hindouisme, mais aussi et surtout dans l’hésychasme, de calquer le rythme de la récitation sur celui de la respiration. On réciterait ainsi par exemple : « Seigneur Jésus-Christ » sur l’inspiration, puis : « Aie pitié de moi » sur l’expiration. Ce rythme, plus lent, force à la répétition mentale et associe durablement prière et respiration, tant et si bien que très vite, une profonde inspiration peut déclencher chez le méditant le réflexe de commencer une nouvelle récitation.
Enfin, l’on conseille parfois d’aligner le rythme de la prière sur celui du pouls en récitant un mot sur chaque battement de cœur. Cette technique moins souvent évoquée est aussi plus difficile à mettre en œuvre, le pouls étant bien plus difficile que le souffle à surveiller tout au long de la journée.