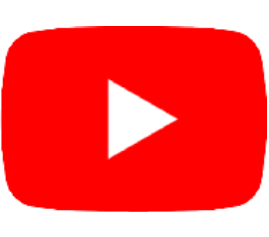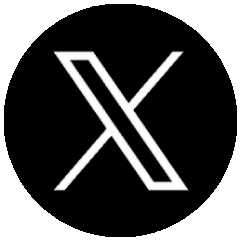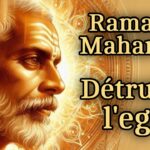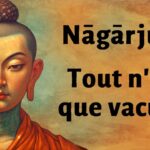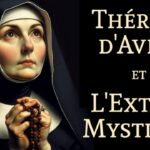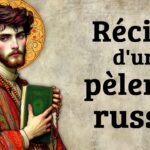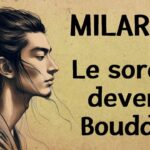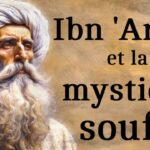La loi de l’impermanence nous amène inévitablement à nous interroger sur nos attachements. Il ressort de nos réflexions que le bonheur nécessite une absence d’attachement, un détachement donc, car celui qui s’attache à un bien finit toujours par le perdre. Toute chose étant impermanente, on perd sa santé, ses possessions, ses proches, tant et si bien qu’un attachement est toujours une souffrance programmée.
L’identification au corps
Parmi les attachements les plus forts de l’homme se trouve l’attachement au corps, qui va de pair avec l’identification au corps. Il est naturel de s’identifier soi-même à son propre corps.
À la question : « Qui suis-je ? », nous répondons que nous sommes le corps que nous occupons, et nous disons : « C’est moi » en voyant notre corps ou notre visage sur une photo.
Tout cela semble logique, évident même, mais ne l’est pourtant pas dans les doctrines orientales. En effet, on trouve dans le bouddhisme comme dans l’hindouisme cette idée récurrente que le monde physique est une émanation du mental.
Le monde physique est issu du mental comme le sont les rêves, et n’ont pas de réalité propre. Dans cette optique, s’identifier à son corps physique revient à s’identifier à un sous-produit illusoire du mental, ce qui n’a pas de sens. Si c’est par notre activité mentale primaire qu’est généré un corps secondaire, il est alors plus judicieux de s’identifier au mental.
Qu’est-ce que le Soi ?
Mais l’ennui, c’est que l’identification au mental pose aussi des problèmes. Dans son livre « Raja-Yoga », Vivekananda nous raconte l’histoire d’un dieu qui s’interroge sur lui-même. Il sait, car on le lui a enseigné, qu’il est le Soi, mais ne sait pas ce qu’est ce Soi qu’il est censé être.
Il commence par supposer que le Soi est son corps. Il s’identifie alors au corps. Mais cette idée ne le satisfait pas : le corps est mortel, tandis que le Soi est permanent et immuable. Dès lors, le corps ne peut pas être le Soi.
Le dieu imagine alors que le Soi doit être l’énergie vitale qui anime son corps. Mais à nouveau un problème se pose : l’énergie vitale varie. Le dieu sait qu’il a de l’énergie lorsqu’il mange, mais qu’il n’en a plus lorsqu’il jeûne. Le Soi pourtant ne varie jamais, il ne peut donc pas être l’énergie corporelle.
Alors le dieu associe le Soi au mental, ce qui ne fonctionne toujours pas puisque le mental, lui aussi, évolue sans cesse, au gré des idées et des émotions.
Il finit par en déduire qu’il est lui-même le Soi, lui-même au-delà de son corps, de son énergie et de son mental. Il est ce principe permanent, immortel et immuable du Soi.
Le Soi est ce qu’il est
Comme souvent dans les doctrines orientales, les réponses simples nous laissent sur notre faim. « Il est lui-même le Soi », qu’est-ce que cela signifie ? Difficile à dire, car la prémisse et la solution semblent se confondre.
Que suis-je ? Je suis le Soi.
Qu’est-ce que le Soi ? C’est ce que je suis.
Si la formule rappelle le « Je suis celui qui suis » de l’Exode, elle relève surtout de la réponse circulaire, ou du serpent qui se mord la queue. En réalité, elle renferme un enseignement capital : par essence, le Soi est indescriptible.
De par sa nature, le Soi transcende toute la création. Il est, selon les doctrines hindoues, le principe qui précède tous les autres principes, il est donc d’une nature métaphysique. Transcendant toute chose, le Soi ne peut être décrit, puisque décrire une chose consiste à la catégoriser. Or, comment catégoriser ce qui est à l’origine de toutes les catégories, et qui les transcende donc toutes ?
Définir une chose, c’est la limiter à certains concepts et l’exclure d’autres. Mais si le Soi transcende tout concept, peut-il être enfermé dans certains et exclu d’autres ? Dès lors, peut-on le décrire ? Il semble que non.
La méthode apophatique
Une fois de plus nous restons sur notre faim, car à la recherche de vérités, nous tentons d’imposer des concepts physiques à des entités métaphysiques. Mais les deux sont incompatibles, et décrire le Soi par des concepts physiques reviendrait à mesurer une distance en kilogrammes, ou à convertir des parfums en chiffres. Il y a incompatibilité de langage.
Il existe pourtant une manière de définir le Soi, qui ne consiste pas à décrire ce qu’il est, mais à nous attarder sur ce qu’il n’est pas. On appelle cette méthode d’anti-description une réflexion apophatique.
Lorsqu’on dit que le Soi n’est ni le corps, ni l’énergie corporelle, ni le mental, on en fait une description apophatique et, mine de rien, on progresse dans notre compréhension du Soi. Il faut croire en tout cas que c’est le mieux qu’on puisse faire pour le saisir.
Si le Soi (mais cela vaut aussi pour Dieu, puisque les deux se rejoignent systématiquement) ne peut être décrit car il ne s’identifie à rien, alors listons toutes ces choses qu’il n’est pas. C’est la méthode apophatique. Le Soi n’est ainsi pas un objet, ni un corps physique, il n’est pas non plus une idée, une humeur, un son, etc.
Plotin pousse la réflexion apophatique plus loin encore : puisque Dieu a créé tout ce qui est, et qu’Il a même créé le concept d’être, alors Il ne peut pas Lui-même être décrit comme « étant » quelque chose. Mais étant pourtant à l’origine des choses, il ne peut pas non plus ne pas être quelque chose. On en arrive à ce paradoxe bien connu des hindouistes : Dieu ou le Soi n’est ni être, ni non-être.
Neti neti
Dans l’hindouisme, et plus particulièrement dans l’école du jnana-yoga (yoga de la connaissance), la méthode apophatique existe sous la forme de « neti neti ». Cette expression signifie « ni ceci, ni cela ». Neti neti est donc, comme l’apophatisme, une méthode d’exclusion.
Neti neti consiste à méditer sur le Soi en observant la création ou le monde environnant, et à dire d’un objet (un objet concret, une idée, une émotion, etc.) que le Soi n’est pas cette chose-là.
Cette chaise ? Le Soi n’est pas cela, car elle est impermanente.
Ce désir ? Le Soi n’est pas cela, car il n’a pas toujours été présent.
Le Soi n’est ni ceci, ni cela, c’est l’enseignement de neti neti qui doit être intégré en profondeur. C’est une certitude totale qui doit naître chez le méditant que le Soi est la seule chose réelle, que le reste est inconsistant et illusoire, et que rien de ces choses illusoires n’est le Soi. Une fois toutes ces choses éliminées, le Soi, dit-on, se révèle par lui-même, comme l’espace vide d’une pièce dont on a retiré tout ce qui l’encombrait.
Faire le vide
L’idée de neti neti n’est pas nouvelle. En réalité, toutes les spiritualités proposent de trouver Dieu ou le Soi en excluant le reste.
Dans l’hésychasme, on emploie pour cela la « garde du cœur » qui vise à exclure de notre pensée toute idée autre que Dieu jusqu’à ce qu’Il se révèle de Lui-même. Maître Eckhart, lui, nous invite pour trouver Dieu à nous détacher de toute chose.
Dans l’hindouisme, le karma-yoga enseigne également le détachement de tout objet de convoitise, tandis que dans le raja-yoga, l’exercice de pratyahara, comme la garde du cœur hésychaste, enseigne à se couper des stimulations extérieurs.
Dans la méditation Dhikr du soufisme, là encore, l’esprit se retranche en lui-même et n’admet d’autre pensée que celle de Dieu.
Dans toutes ces doctrines, l’idée de Dieu ou du Soi, et donc son expérience, est incompatible avec toute autre. On ne décrit pas l’idée de Dieu par d’autres idées, on ne compare pas Dieu à d’autres choses, et on ne pense pas à Dieu en pensant à d’autres choses, tout comme on n’observe ni la lumière dans l’obscurité, ni l’espace dans un lieu encombré.